
Le père Lucien Legrand à Pokara , Népal, janvier 2025
Les 10 et 11 janvier 2025, le St Peter’s Pontifical Institute de Bangalore célébrait le jubilé d’or de sa fondation. C’est, en effet, le jour de l’Épiphanie 1976 que la faculté de théologie a été érigée par le décret Ecce vir Oriens de la Congrégation pour l’éducation catholique. Cet Institut comprend aujourd’hui une faculté de théologie, un centre d’études de droit canon et un institut de philosophie. Il est donc habilité à décerner des diplômes universitaires de licence, pour la philosophie et le droit canon, et de doctorat, pour la théologie.
La création de cet institut représente une étape impor- tante d’une longue histoire. Elle est aussi symbolique du développement qui a amené l’Église en Inde dans son état actuel.
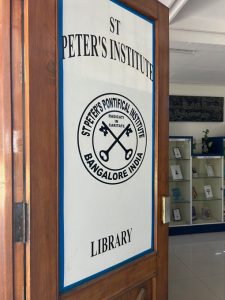
Entrée de la bibliothèque du séminaire Saint-Pierre de Bangalore, Inde
Promouvoir un clergé local
L’histoire remonte à 1776 quand, suite à la suppression de la Société de Jésus par le pape Clément XIV, les Missions Étrangères se voient confier les missions fondées par les jésuites dans le sud de l’Inde. Les Missions Étrangères avaient été fondées plus d’un siècle plus tôt avec le but spécifique de promouvoir un clergé et un épiscopat local en Asie. Fidèles à cette vocation, et bien que très peu nombreux, les quelques prêtres des Missions Étrangères et les quelques jésuites qui acceptèrent de continuer leur mission dans le nouveau cadre se donnèrent la priorité d’ouvrir un séminaire à Pondichéry en 1778. Les premiers prêtres indiens formés dans ce séminaire furent ordonnés à la fin de 1788 et au début de 1789. Par la suite, mais non sans difficultés, le nombre de séminaristes et de nouveaux prêtres locaux ne cessa de croître. Le cadre resserré de la ville de Pondichéry ne permettant pas les agrandissements requis, le séminaire fut transféré sur un terrain spacieux à Bangalore qui, par ailleurs, à 900 mètres d’altitude, offrait l’avantage d’un climat plus favorable aux études. En 1962, l’affiliation à l’Université de la propagande de Rome permit aux étudiants d’obtenir le baccalauréat en théologie. Dans l’esprit de Vatican II, en 1968, la Société des Missions Étrangères remit un séminaire en bon état de marche à la hiérarchie locale des deux archevêchés de Pondichéry et de Bangalore et de leurs suffragants.
Visées œcuméniques
En même temps, plusieurs congrégations religieuses avaient établi leurs scolasticats à Bangalore. Une congrégation religieuse de rite syro-malabare avait, notamment, lancé un séminaire de rite oriental très bien équipé. Dans l’enthousiasme suscité par le Concile, l’Association théologique de Bangalore fut fondée pour établir un cadre d’échanges entre les professeurs des différentes institutions. Cette association était œcuménique, intégrant aussi l’United Theological College protestant. De cet esprit de collaboration et de cette ferveur postconciliaire, se dégagea l’idée de fédérer ces institutions en une université ecclésiastique. Des comités furent formés pour élaborer une constitution et mettre au point des programmes communs. Le projet était sans doute trop ambitieux et il échoua. Pour en sauver au moins l’esprit, on obtint des congrégations romaines l’élévation en facultés de théologie des deux séminaires les plus importants : St. Peter’s, pour le rite latin, et Dharmaram, pour le rite syro-malabare. Avec la faculté théologique protestante, Bangalore avait donc trois institutions de niveau académique, qui coopèrent, d’ailleurs, étroitement avec échanges de professeurs, facilités d’accès aux bibliothèques, symposiums interfacultés, et même compétitions sportives. Les débuts furent modestes. On commença par proposer des spécialisations en missiologie et en études bibliques. La première promotion de candidats à la licence comptait sept étudiants, puis le nombre tomba à deux pour reprendre par la suite et ne pas cesser de croître. La spécialisation en études bibliques fut ouverte en 1981. Jusqu’en 2024, elle conduisit 303 candidat(e)s à la licence et 65 au doctorat. À la demande de la Conférence épiscopale de l’Inde, un centre de droit canon fut ouvert en 1987. Affilié à la faculté de droit canon de l’université Urbaniana de Rome, il a préparé 410 candidats à la licence. Il est maintenant en passe d’être reconnu comme faculté de droit canon.
L’Institut est relayé, à travers tout le sud de l’Inde, par neuf séminaires et autres institutions qui lui sont affiliés. Il propose ses services aussi au laïcat, en offrant, depuis 1980, un extension course de week-end. Il vient aussi de lancer un cours de théologie en ligne : le Spot (St. Peter’s Online Theology). Il intéresse 935 inscrits.
Le cas des facultés de Bangalore n’est heureusement pas unique. L’Inde compte cinq autres facultés de théologie. Deux sont gérées par la Société de Jésus, l’une à Pune et l’autre à Delhi. Deux autres au Kérala et une à Ranchi sont sous la responsabilité des Conférences épiscopales locales. Il faudrait aussi y ajouter les différentes chaires d’études chrétiennes rattachées aux diverses universités de l’Inde. Nous voyons le chemin parcouru depuis le temps où, à la veille du Concile, au début des années 1950, l’Inde ne comptait que deux biblistes, ayant une licence en études bibliques, et tous deux étrangers.
L’importance de l’inculturation
Ce développement représente un aspect important de la mission. Nous insistons sur l’importance de l’inculturation et notre Revue vient de consacrer un numéro spécial à la question (cf. n° 610 de janvier 2025). Mais l’inculturation ne se réduit pas à l’expression artistique et aux formes de célébration liturgique. Elle concerne les structures profondes de la vie en Église. Une étape fondamentale a été la création d’une hiérarchie locale. Tant que l’Église n’était représentée que par des évêques missionnaires venus de l’étranger, elle ne pouvait paraître que comme un produit d’importation. L’étape d’un épiscopat local a été franchie depuis longtemps. Pour ce qui est des Missions Étrangères en Inde, le processus a commencé en 1931, avec la nomination d’un évêque indien à Kumbakonam. Il s’est terminé en 1955, avec le décès du dernier évêque MEP à Pondichéry. Depuis de nombreuses années, d’ailleurs, il avait confié la direction du diocèse à son coadjuteur indien. Ce processus d’indianisation s’est développé en parallèle dans les congrégations religieuses et la direction des œuvres sociales et universitaires. L’Église en Inde est maintenant un corps bien structuré, reposant sur des bases enracinées dans l’identité indienne.
Mais ce corps a besoin de l’équipement requis pour l’exercice de ses fonctions. C’est en particulier le rôle des institutions d’études supérieures. Elles permettent à l’Église en Inde de se situer dans la société indienne, sa culture, sa pensée, ses problèmes, son évolution. Leur rôle est important et unique. Les universités occidentales ne peuvent pas se substituer à la recherche sur le terrain. Leurs recherches et leur acquis sont certainement enrichissants et, comme toute pensée authentique, ont une portée universelle. Mais nous ne pouvons pas leur demander de porter les soucis, les exigences et les lignes d’intérêt venant d’un autre monde. Ainsi, au moment du Concile, le grand théologien Yves Congar posait le problème de l’œcuménisme à l’égard des religions non chrétiennes. À propos de la création d’un Secrétariat pour les religions non chrétiennes, il écrivait dans son journal : « Il semble qu’on ne voie pas bien que faire ? Que peut être un dialogue du catholicisme avec le bouddhisme ou le confucianisme ? […] Où aurions- nous les hommes idoines ? » (Mon journal du Concile, II, p. 21). Les « hommes idoines » ne peuvent se trouver que parmi ceux qui vivent en contact quotidien avec ces grandes religions de l’Asie. À un niveau plus concret, dans son programme de licence en études bibliques, notre faculté offre un cours sur la théorie et la pratique de la traduction donné par des praticiens de la traduction biblique dans un pays qui a 22 langues officielles, 174 autres langues et 544 – ou plus ? – dialectes. Un autre cours porte sur les méthodes d’interprétation des Écritures de l’hindouisme qui développent, de façon très approfondie, une approche du texte très différente des techniques exégétiques occidentales.
Être la voix de l’Évangile
L’émergence et le développement de centres de réflexion philosophique et théologique en Asie et en Afrique posent un double défi. Défi pour ces centres de répondre, de façon créative, à leur vocation d’être la voix de l’Évangile dans d’autres mondes. Pour l’Inde, en particulier, le défi est comparable à celui des Pères grecs et latins ayant à exprimer leur foi au Messie galiléen dans le langage, la culture et la pensée du monde gréco- romain. Encore la religion gréco-romaine était-elle sur son déclin, tandis que l’hindouisme et le bouddhisme sont actuellement plus vivants que jamais. En sens inverse, le défi qui se pose à la pensée chrétienne occidentale est de savoir prêter une oreille attentive à ces voix venues d’ailleurs, sans complexe de supériorité ni relent postcolonial. C’est ce que demande la marche en avant de l’Église vers sa plénitude authentiquement « catholique », universelle.
P. Lucien Legrand, MEP
CRÉDITS
Y. Vagneux
